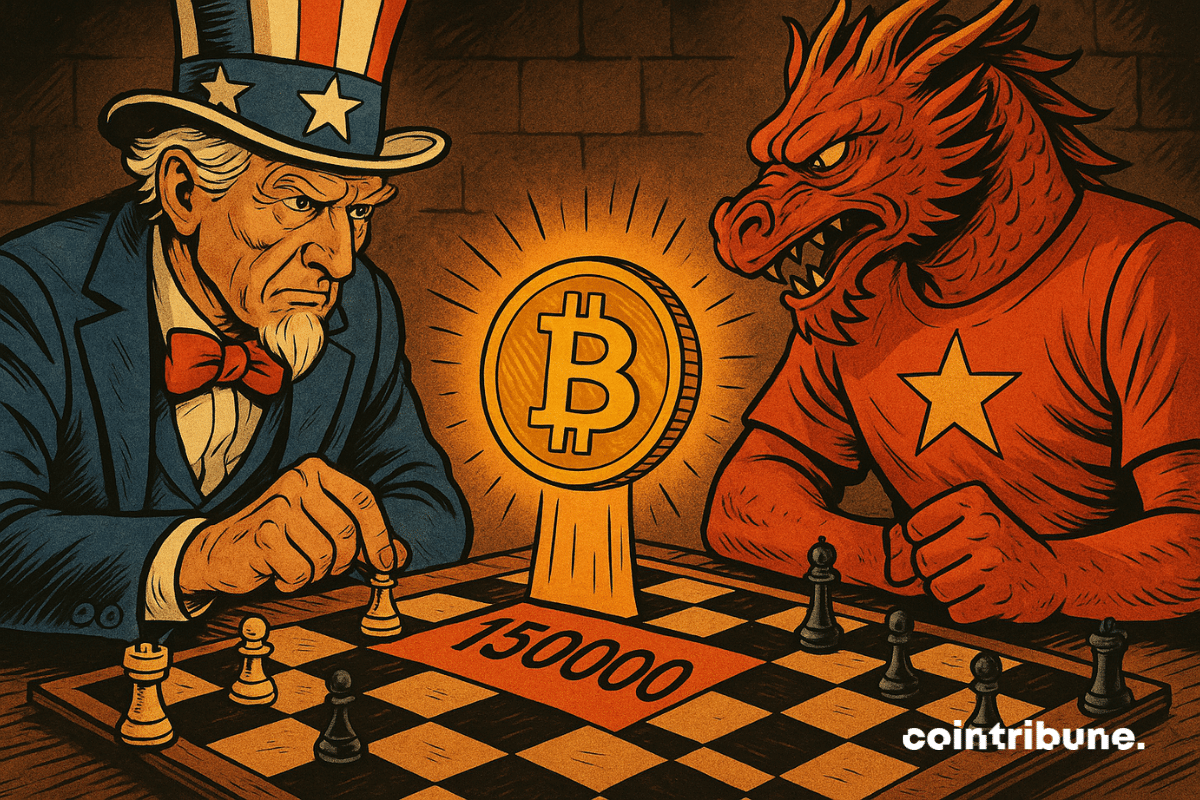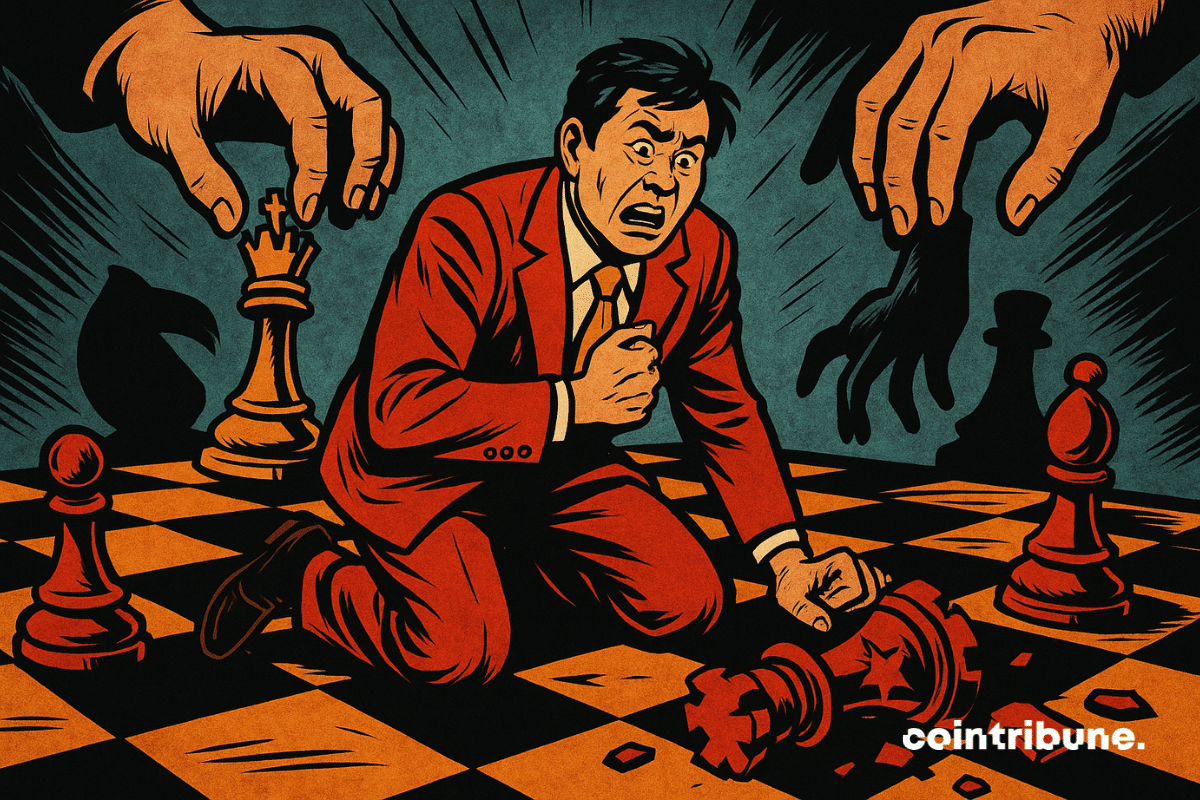Après plusieurs années d’hostilité vis-à-vis du bitcoin, Taïwan pourrait bientôt reconsidérer son point devue étant donné sa situation géopolitique précaire.
Thématique Géopolitique
Trump lève (un peu) le pied sur les surtaxes douanières : l’économie respire, les analystes toussent, et Pékin ricane. 90 jours de trêve, ou 90 jours avant l’orage ?
Longtemps perçus comme des suiveurs, les BRICS prennent aujourd’hui la tête de la croissance mondiale. D’après les dernières prévisions du FMI, ces puissances émergentes enregistrent en 2025 une dynamique économique nettement supérieure à celle des États-Unis. Ce basculement quantitatif devient stratégique : la montée en puissance des BRICS n’est plus une tendance, c’est un fait. Leur performance collective redéfinit les rapports de force et impose une relecture des équilibres géoéconomiques.
Le 13 mai 2025 à Riyad, Donald Trump a signé avec l’Arabie saoudite un partenariat stratégique estimé à 600 milliards de dollars. Au-delà de la somme, c’est la nature de l’alliance, entre défense, tech et énergie, qui interpelle. Tandis que Washington renforce son ancrage au Moyen-Orient et que Riyad accélère sa mutation post-pétrole, cet accord redéfinit les rapports de force entre deux puissances en quête d’influence globale.
Les États-Unis et la Chine conviennent de suspendre les tarifs pendant 90 jours, ce qui renforce l'optimisme du marché des cryptomonnaies avec le Bitcoin et d'autres enregistrant de forts gains.
Quand Pékin et Washington se serrent la pince, Wall Street bondit, l’or se dégonfle, et le bitcoin, tel un phénix numérique, flambe sous l’effet des douanes en baisse.
Dans un monde où les lignes de fracture géopolitiques se déplacent rapidement, l’Arabie saoudite joue une partition délicate entre deux blocs rivaux. Sollicitée par les BRICS, mais toujours étroitement liée aux États-Unis, Riyad temporise, suspendant son adhésion officielle malgré des signaux d’ouverture. Tandis que Pékin séduit par ses promesses économiques et que Washington agite la menace tarifaire, le royaume ménage ses options. Ce flou tactique masque-t-il une orientation stratégique déjà actée ou prépare-t-il un rééquilibrage majeur sur l’échiquier mondial ?
Tandis que la guerre russo-ukrainienne s’enlise dans sa quatrième année, une possible rencontre entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine à Istanbul pourrait rebattre les cartes. Pour la première fois depuis des mois, Kiev accepte l’idée de pourparlers directs. Zelensky a annoncé ce dimanche 11 mai qu’il attendrait Poutine le jeudi 15 à Istanbul. Cependant, l’Ukraine pose une condition ferme : aucun échange ne se fera sans un cessez-le-feu total, exigé dès ce lundi. Il s’agit d’une exigence lourde de sens, dans un conflit où chaque geste diplomatique reste scruté.
Économie chinoise : les prix fondent, le peuple économise, Pékin bricole, les plats changent. Le dragon tousse, mais sort encore la carte mystère pour ne pas finir rôti.
Tandis que le conflit en Ukraine franchit un cap critique, Kiev et ses alliés occidentaux avancent une proposition de cessez-le-feu de 30 jours, intégral et sans conditions. Soutenue par Washington et les grandes capitales européennes, cette initiative vise à ouvrir une brèche vers des pourparlers. Cependant au-delà de l’appel à la trêve, une interrogation domine : Moscou y verra-t-elle une véritable main tendue ou une manœuvre tactique dissimulant un avantage stratégique pour l’Ukraine ? La réponse pourrait redessiner l’équilibre des forces sur le plan diplomatique.
Morgan Stanley estime que le bitcoin est désormais suffisamment important pour être considéré comme une monnaie de réserve internationale.
Alors que la guerre commerciale sino-américaine semblait figée dans un jeu de représailles sans fin, un geste inattendu vient raviver l’espoir : Pékin accepte des pourparlers officiels avec Washington. Une première depuis des mois. Cette rencontre, bien plus qu’un simple échange diplomatique, cristallise les tensions profondes qui secouent le commerce mondial et l’économie des deux géants.
Les marchés européens ont entamé la semaine sans cap clair, coincés entre deux incertitudes majeures : les décisions imminentes des banques centrales et la crainte d’un durcissement commercial mondial. Ce lundi 5 mai, les principales places financières affichent une prudence manifeste, illustrée par des indices en léger repli et des volumes d’échange faibles. En effet, les investisseurs attendent fébrilement les prochaines annonces de la Fed et de la Banque d’Angleterre, dans un climat où chaque signal monétaire ou diplomatique peut faire basculer la tendance.
Et si une guerre commerciale pouvait déboucher sur un affrontement nucléaire ? L’hypothèse paraît extrême, jusqu’à ce qu’elle soit émise par Warren Buffett. En effet, lors de l’assemblée annuelle de Berkshire Hathaway, l’investisseur a averti que les politiques économiques de Donald Trump, perçues comme agressives, pourraient alimenter des tensions mondiales aux conséquences incontrôlables. Une prise de position inhabituelle, lourde de sous-entendus, dans un contexte international déjà fragilisé par des rivalités croissantes.
La Chine espérait redorer son blason économique à coups de gestes d’apaisement envers les États-Unis. Las, malgré une réduction partielle des droits de douane, les perspectives ne s’éclaircissent pas. L’économie chinoise vacille, prisonnière de sa propre inertie et d’une conjoncture mondiale glaciale.
Tandis que les cours du pétrole dégringolent et que la demande reste morose, l’OPEP+ surprend en annonçant une hausse massive de sa production dès juin. Huit membres du cartel rompent avec la prudence récente et ravivent l’incertitude sur un marché déjà sous tension. Derrière ce revirement se dessine un possible tournant géopolitique et économique, entre stratégie de reconquête et prise de risque calculée. Cette décision pourrait bien redessiner les équilibres énergétiques mondiaux.
La CIA découvre que le bitcoin trace mieux qu’un agent double : un retournement cocasse pour une crypto née contre l’État, devenue bras armé de l’État. Quel retournement de veste !
L’UE tente d’éviter une guerre commerciale qui plomberait son économie. Dans cet article, on vous explique comment.
L’économie américaine recule pour la première fois depuis 2022. Vers une récession ? Découvrez quelques chiffres clés dans cet article !
Tandis que les sanctions économiques visaient à étouffer Moscou, la Russie enregistre une croissance de 4,1 % en 2023. Ce chiffre, confirmé par les autorités russes, bouscule les certitudes de Washington et de ses alliés. Dans un climat de guerre en Ukraine et de recomposition des alliances monétaires, le retour en force de l’économie russe révèle une stratégie de contournement efficace, portée par les BRICS. Cette donnée interroge sur l’efficacité des sanctions occidentales et rebat les cartes du jeu géoéconomique.
L’économie américaine, ce géant qui semblait jadis indomptable, vacille aujourd'hui sur une corde raide, entre tensions commerciales exacerbées et perte de confiance intérieure. Si certains parlaient d'un simple coup de vent, la tempête pourrait bien être d'une violence inattendue.
Pendant que le dollar fait des claquettes sur un fil de tweets présidentiels, l’euro, lui, trottine vers le trône monétaire, galvanisé par les bévues de son rival étoilé.
Entre Washington et les BRICS, l’Inde joue un numéro d’équilibriste. Officiellement attachée au dollar, elle laisse pourtant filtrer des signaux favorables à des alternatives monétaires. Dans un contexte de recomposition géopolitique où la devise américaine cristallise les tensions, la posture ambivalente de New Delhi intrigue autant qu’elle inquiète. Entre loyauté affichée et stratégies discrètes, l’Inde s’impose comme un acteur clé dans le bras de fer monétaire mondial.
En avril 2025, le Fonds monétaire international (FMI) a assombri les perspectives économiques des États-Unis avec une révision brutale : une croissance projetée à 1,8 %, contre 2,7 % initialement prévu. Ce revirement, le plus marqué depuis la crise de 2008, n’est pas un simple ajustement technique. Il reflète une conjonction de risques – guerres commerciales, inflation tenace, décrochage de la consommation – qui menace de redessiner l’équilibre économique mondial. Derrière ces chiffres, un constat implacable : les décisions politiques récentes ont précipité une onde de choc dont les répliques pourraient durer.
Avec Trump, nous assistons au passage d'une guerre commerciale à une guerre économique totale entre les Etats-Unis et la Chine.
Les États-Unis devront abandonner le privilège exorbitant du dollar si l'objectif est vraiment de redevenir une puissance industrielle. De bon augure pour le bitcoin.
Pendant que Wall Street se vide les poches, le bitcoin bombe le torse, flirte avec les sommets et draine des milliards — la crypto devient le nouveau refuge des capitaux capricieux.
L'or continue de briller, à 3 400 dollars l'once. De bon augure pour le bitcoin qui héritera tôt ou tard de cette fortune.
Tandis que les États-Unis durcissent leur arsenal tarifaire, le reste du monde s’organise. Ainsi, le bloc des BRICS attire les économies en quête d’indépendance stratégique. En rupture avec l’ordre monétaire établi, cette alliance redessine les circuits d’échange et fragilise l’emprise du dollar. Une bascule silencieuse, mais structurante se joue.
Combien de bitcoins les États-Unis vont-ils acheter et comment ? Le conseiller à la Maison-Blanche Bo Hines préconise d’utiliser les recettes des taxes douanières.